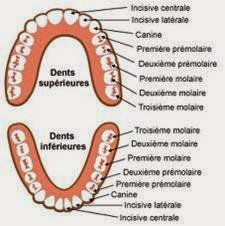POLYRADICULO NEVRITES INFLAMMATOIRES AIGUES
POLYRADICULO NEVRITES INFLAMMATOIRES AIGUES SYNDROME DE GUILLAIN-BARRE Dans sa forme classique, le syndrome de GB est une polyradiculopathie démyélinisante inflammatoire aiguë idiopathique. Il peut être observé à tout âge avec une égale fréquence dans les deux sexes. Les lésions responsables sont des foyers de démyélinisation segmentaire qui intéressent les nerfs sur toute leur longueur, y compris au niveau des racines. Les axones sont relativement préservés. Les lésions démyélinisantes sont associées à des infiltrats inflammatoires périvasculaires.